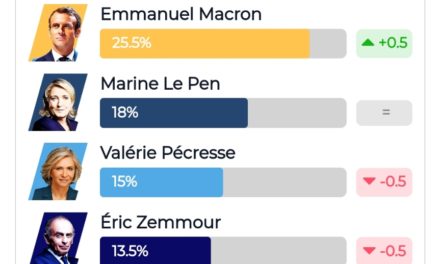Pour la chercheuse ivoirienne Aya Laurie Kouadio, le phénomène des « microbes » tire l’alarme d’une société obsolète en pleine mutation.
Délinquance juvénile meurtrière à l’issue de la crise post électorale de 2011 en Côte d’Ivoire, les « microbes » persistent aujourd’hui encore dans les ruelles d’Abidjan, la capitale économique. Pour Aya Laurie Kouadio, chercheuse ivoirienne à Indigo (Initiative de Dialogue et Recherche Action pour la Paix en Côte d’Ivoire) et autrice du livre « Les Microbes, nouveau visage de la criminalité urbaine à Abidjan », les « microbes » sont semblables aux enfants soldats ; produits d’une période confuse, d’un entre-deux, « un temps de ni paix, ni guerre ». De la saleté, naissent des microbes et bactéries en tout genre, les relents d’un environnement à l’abandon. Des enfants en quête, souvent, d’un bonheur simple.
Quels sont les éléments déclencheurs de ces phénomènes de délinquance juvénile ?
Aya Laurie Kouadio — Lorsque j’ai étudié les « microbes », j’ai analysé réellement le « microbe » comme des bactéries, révélatrices de l’état de santé de l’endroit où ils se trouvent. La géographie est un élément déclencheur de la trajectoire de ces enfants. Ils vivent dans des quartiers où l’on n’a pas envie de vivre. Ce sont des lieux sans aménagement de territoire. Pas d’eau, pas de courant, pas d’hôpitaux ni d’école publique. C’est dans ces quartiers là, que les microbes sévissent. Ils appartiennent à des familles où les parents n’ont pas de temps pour eux ; des maisons, où l’on est 5 ou 10 pour un T2. Alors, il faut être dehors. Dehors, on peut vendre de la drogue, être dans un groupe d’ami, pour voler, se battre, et gagner plus d’argent .
Il faut aussi comprendre que dans les bandes ivoiriennes, il y a les microbes, mais il y a aussi le « vieux père ». Il est le papa de cette bande, de ces enfants. Ils ont confiance en lui. Il devient un modèle de réussite, même si il est proxénète, même si il tue… C’est une figure paternelle. Si l’on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre le phénomène des microbes. Les microbes cherchent à se réinventer, ils sont en quête de quelque chose qu’ils n’ont pas. Trouver une famille qui les aime et les comprend, qui prend soin d’eux. Le « vieux père » répond à ces besoins. C’est ça qu’un enfant veut. Ce lien si fort, entre le vieux père et les microbes, c’est une variable clé. Par la suite, plusieurs d’entre eux — parmi ceux qui ne sont pas morts —sont partis en Europe, pour « se chercher ». D’autres parviennent à faire des petits métiers, ou fondent une famille. C’est là que l’on voit que ce qu’ils recherchent, c’est juste une vie meilleure.
Ils se concentrent uniquement dans les périphéries ?
Oui, c’est plutôt en périphérie. Abidjan, c’est un peu comme à Paris, mais en pire. Tout se concentre à Abidjan. Il y a 12 communes, et dans ces 12 communes, il y a des « communes dortoirs ». Il y a vraiment une sorte de ségrégation — le mot est un peu fort, mais je l’utiliserai — entre ceux qui ont les moyens, avec des communes résidentielles, et les « communes dortoirs », pour ceux qui sont venus chercher une place au soleil, dans les villes urbaines.
La Côte d’Ivoire, comme beaucoup d’autre pays africains qui ont vécu des guerres civiles, a une grande ville économique — la seule souvent — réceptrice d’un afflux [conséquent] de personnes fuyant les zones rurales, particulièrement lors des crises comme celle de 2002. Ce sont des personnes qui abandonnent tout pour fuir. A l’arrivée, ils se logent dans des quartiers périphériques comme Abobo, au nord d’Abidjan, ou Yopougon, à l’ouest. Ces quartiers deviennent des communes dortoirs, très peuplées. De facto, ces communes-là, et les gens qui y vivent, sont marginalisés. Et dans cette sorte de reconstruction interne, il y a tout ces phénomènes déviants qui s’y opèrent. Rien n’a été prévu, les gens vivent au jour le jour. J’ai remarqué également une chose. Dans les quartiers marginalisés il y a des marginaux, mais il y aussi d’autres marginaux qui marginalisent les autres : dans la périphérie, il y a encore des périphéries. Ainsi, le problème reste et demeure, dans ces périphéries. Mais pas dans les quartiers comme Le Plateau, au centre d’Abidjan, ou Cocody, qui sont des quartiers résidentiels.
En France, nous avons les Apaches, les Blousons Noir, mais la mémoire collective semble les avoir oubliés face aux rixes récentes… En est-il de même en Côte d’Ivoire ? Les Microbes sont-ils vraiment un « nouveau » phénomène ?
Lorsque l’on parle des microbes, on a l’impression que c’est une première. Mais les microbes ne sont qu’une mutation, une reproduction, ou une métamorphose de phénomènes de délinquance plus anciens. C’est parce que l’on n’a pas résolu le problème qu’ils sont là. Les microbes reproduisent des dynamiques des bandes passées. Avant, il y avait les Nouchis (années 70) — des bandes parés de gri-gri qui semaient la terreur à Abidjan et combattait avec des armes blanches . Puis, sont apparus les Ziguehi (de l’ivoirien zigbohi, « celui qui se bouge », un garçon courageux et débrouillard), plutôt amateur d’art martiaux. Ils se battaient à main nues. Chaque quartier avait ses loubards. C’était une force au sein de la jeunesse, avec un gros potentiel de violence. Les Ziguehi d’hier sont les « vieux pères » d’aujourd’hui. Ils ont 40 ans, ils ne peuvent plus aller dans la rue pour faire des casses. Demain, le microbe de 15 ans sera un vieux père de 30 ans. Être « vieux père », c’est quelque part le rêve de plusieurs jeunes microbes ; être leader d’une communauté, et avoir eux aussi, à leur tour, des microbes à leur solde. C’est un cercle vicieux.
Quelle différence entre les bandes d’autrefois et celle d’aujourd’hui ?
Autrefois, ils n’étaient pas aussi jeunes. C’étaient presque des adultes, dans la vingtaine, qui auraient pu être étudiants. C’était des vagabonds qui n’avaient pas pu aller à l’école. Aujourd’hui, les microbes sont beaucoup plus jeunes, de 8 à 20 ans. Certains sont scolarisés. Ils vont à l’école. Et les plus petits, sont les plus virulents. Ils ne réfléchissent pas.
Et puis, même si les délinquants d’avant ont également connu la marginalité, les problèmes économiques… ils ne sont pas apparus suite à un contexte de guerre ou de crise politique, contrairement aux microbes. Certains des microbes que j’ai étudié ont fait leurs armes dans les conflits et la violence de la crise post-électorale de 2010/2011. Même si ils n’ont pas participé activement à la guerre. C’est dans leurs quartiers, dans des communes comme Abobo, que la guerre a battu son plein en 2011. Ils ont vécu la guerre, ils ont entendu les Kalachnikov. Ils ont vu les corps. Ils ont vu les machettes. La réalité à laquelle ont été exposés ces enfants là, et qui fait parti de leur héritage, est différente de celle des autres délinquants. Il y a un documentaire qui les nomme « les enfants de la crise ». La crise post-électorale a laissé un certain vide dans ces communautés, en particulier à Abobo [ndr : quartier d’Abidjan dans lequel les microbes ont été particulièrement nombreux]. Moi, je n’habitais pas à Abobo à cette époque, mais ce que j’entendais me traumatisait. Pour ceux qui vivaient là-dedans, c’était inimaginable. On chevauchait les corps, il n’y avait pas de nourriture. Il y avait des obus qui détruisaient les marchés. On sentait la putréfaction des corps, on voyait les hommes qui tiraient, et, souvent, les enfants qui ont été des microbes portaient les balles pour les « grand frères » [ndr : terme affectif pour les ivoiriens] qui allaient combattre. Ils portaient les armes, ils donnaient la localisation des camps adverses. C’était des indicateurs.
A la fin de la crise, on n’a pas su prendre les gens en charge psychologiquement. Il y a eu un moment de liberté, d’absence de la loi, et les armes ont circulé. Lorsque tout est sale, naturellement, il y a des microbes et des bactéries. C’est de là que les microbes émergent. Du reliquat de la crise. Souvent, certains disaient « mon père est mort dans la crise, c’était un ancien combattant. » « On s’est retrouvé sans rien. Il fallait que je me débrouille, et mes amis m’ont fait rentrer chez les microbes.» C’est ça la différence. Les microbes pour moi c’est les enfants soldats ; pas en temps de guerre non, mais en temps de « ni paix, ni guerre ». Au Libéria, après la guerre, les enfants sont tombés dans la délinquance. Il n’y avait rien pour les socialiser, et ils ne connaissaient que ça. La violence. Les microbes, c’est un peu ça. Même s’ils n’ont pas combattu comme les enfants soldats du Libéria, après la guerre, ils étaient un peu déboussolés. Les microbes, c’est le résultat d’un agrégat de circonstances et de situations qui ne date pas d’aujourd’hui.
Quelle est la réponse juridique de l’Etat ?
Chez nous, le droit, ce n’est pas très développé. Les « microbes », c’est la population qui a donné ce nom-là à ces enfants, si nuisibles. En Afrique, il y a ces appellations [familières] dans les rapports inter personnels [ndr : pour des personnes qui ne sont pas de la même famille]. « Ma soeur » « le père » « tonton » « petit » « fiston » … Alors, quand la population a vu ces petits de 8 à 19 ans, avec des machettes, on les a tout de suite appelé « microbes ». On n’en veut pas. Des êtres nuisibles que l’on veut éliminer du corps social. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, contrôler ces phénomènes [de haine], l’Etat, le droit pénal, a fini par créer une nouvelle terminologie, une nouvelle sémantique plus respectueuse et fragile : « mineurs en conflit avec la loi ». Puis, les centres de rééducation, les CCSR (cellule de coordination de suivi et d’insertion) ont été ressuscités. C’est comme ça, que le droit est intervenu. Ça n’existait pas avant [cette terminologie]. C’était cru.
Quelle relation entretiennent les microbes avec l’Etat ? Quelle influence sur le pouvoir politique ?
Les microbes, ce sont aussi les petites mains sales de l’Etat. Houphouët-Boigny en est un exemple : le gouvernement avait peur de cette jeunesse délinquante, les Zeguehis. Pour que ces délinquants ne puissent pas être incorporés dans les rangs de l’opposition qui venait de naître, il les a pris sous sa tutelle. On les a appelés de manière ironique les « volontaires salariés » : ils avaient la garde des lieux de la jeunesse, des cités universitaires, et en échange, ils étaient à la solde de Houphouët. La Côte d’Ivoire est un pays où chacun est sur ses gardes, particulièrement en matière de politique. Il faut sécuriser son pouvoir, notamment auprès de la population. Les microbes sont la solution. On dit que les microbes sont toujours là parce que, quelque part, ils ont servi la cause du régime en place. Ils sont le relais du pouvoir dans chaque sphère de la société, dans chaque commune marginale. Aux élections, on ne vote pas pour un programme, on vote pour de l’argent, comme dans un système clientélisme.
Ainsi, lors des élections de 2015/2016 notre Premier ministre [ndr : récemment décédé] Hamed Bakayoko a fait appel aux « vieux pères » qui ont de l’influence et le monopole de la violence. Leaders qui ont eux-mêmes fait appel aux microbes. Contre 5000 francs (10 € environ) et un peu de drogue (pour casser toute sensibilité), ils allaient déranger les meetings des opposants. Ils sont prêt à tout pour leur « vieux père » qui leur donne de l’argent et à manger. C’est là qu’on a vu que la chaîne était longue. Les microbes travaillaient pour un vieux père, qui lui-même travaillait pour Hamed Bakayoko, le pouvoir en place. Ce sont des prestataires de services. N’importe qui peut les engager.
Et l’approche policière ? Comment sont réprimés les microbes ?
En 2013/2014, à l’apogée du phénomène, la population tuait les microbes. Aujourd’hui, à Abobo, il y a moins de microbes parce que les gens les ont tellement tué, qu’ils ne reviennent plus. Ils préféraient être entre les mains des policiers, plutôt que dans celles de la population. Parce que le peuple, il ne va pas t’emmener à la police, il va te tuer pour peu qu’il voit un enfant qui ressemble, selon lui, à un microbe. Il y a eu des décapitations. Des patrouilles à 4h du matin, des comités d’auto-surveillance, ont été créés pour surveiller les quartiers sombres. C’était la version douce de l’approche policière.
Mais, il y a eu aussi une forte répression de la part de la police [ndr : à une autre période]. La police faisait des descentes dans les fumoirs, avec des indic. Dans les bas-fond, dans les quartiers les plus reculés, ils traquaient les microbes. Il y a eu beaucoup de morts. Mais si vous tuez un microbe, ils tuent deux policiers. C’était une vraie guerre. Il y avait un couvre feu, à 18h tu rentrais chez toi, parce que quand les enfants descendaient avec des machettes, ils agressaient tout le monde. Ils vous piquent, ils vous tuent, ils n’ont aucun égard. Quand ils connaissaient un policier, il allaient chez lui, pour le tuer. Un jour, les microbes ont décidé de battre en retraite. Ils mouraient trop, la population comme la police les traquaient énormément. C’est à ce moment là que l’on s’est aperçu que c’était trop violent. C’est là, qu’on a commencé à moins tuer les enfants. En 2021, les tueries continuent, mais la violence a considérablement réduit.
Aujourd’hui, les bandes de jeunes tendent à se retrouver sur les réseaux sociaux. Ils se provoquent et se donnent rendez-vous. En Côte d’Ivoire, les réseaux jouent-ils un rôle majeur également ?
Oui, parce que ce sont des fanfarons quand même. Ils aiment bien se montrer. Ils ne font rien de leur argent. Avec l’argent qu’ils volent, ils en donnent un peu à leur parents, à leur mère — la figure de la mère est très importante — et le reste, c’est pour fanfaronner. Ils s’affichent sur les réseaux, dans des bars, au bras des plus belles filles, avec les tout derniers téléphones. Il y a, en Côte d’ivoire, dans notre argot, l’expression « la vie des giga » lorsque l’on parle de la vie de ces jeunes. Comme les giga octets. Chez nous il n’y a pas de forfait à payer par mois. Donc, avec leurs giga internet, ils connectent leur 4G et montrent leur argent, des liasses de billets. C’est tout ce qu’ils peuvent faire. Et, souvent, ce sont des modèles pour les autres. Certains, tous ce qu’ils veulent, c’est avoir les gros téléphones et mener la vida loca. Ces jeunes-là sont quelque part des influenceurs, pour d’autres jeunes qui ne rêvent que de ça. Vivre la vie du paraître. Le phénomène des microbes vis à vis des réseaux sociaux est par ailleurs à regarder en parallèle avec le phénomène des « brouteurs », ces arnaques en ligne en Côte d’Ivoire. A leur débuts, à Abidjan, c’était la même chose. Ils faisaient du boucan, montraient leur argent… C’était des modèles pour les jeunes. Et c’est pareil pour les microbes. Vendre de la drogue, c’est rien à Abidjan. Il y a deux types de microbes. Ceux qui tuent, qui n’ont pas peur de la mort, et ceux qui vendent de la drogue, les « délinquants sans sang ». C’est comme aux États-Unis, ils rappent, ils sortent des albums. Ils promeuvent une certaine vie de boss, avec des richesses que les jeunes peuvent avoir en rentrant dans les magouilles.
Quelles sont les solutions ?
Je n’ai pas trouvé de solution, j’ai proposé des choses qui étaient déjà en place. On garde les enfants pendant 1 an ou 6 mois. Les 3 premiers mois, on les garde au centre. On leur demande ce qu’ils veulent apprendre. On leur donne une éducation civique et scolaire ou on leur apprend un métier. Les 3 mois suivants, ils sont relâchés dans la société. Les psychologues viennent 2 ou 3 fois dans le mois. Puis ils sont laissés à eux-mêmes. Et c’est le problème. Il n’y a pas de continuité. Je préconise un suivi. Essayer une assistance globale à défaut d’une assistance personnelle. Assister non seulement le jeune, mais aussi « le jeune dans sa famille » parce que c’est un tout. Proposer un accompagnement aux parents, à la mère qui s’occupe seule, souvent, de l’enfant. Il appartient à une famille qui ne va pas bien, qui est dysfonctionnelle. Il y a des comités de dialogues, de réinsertion pour socialiser l’enfant, des guides religieux… On doit encore ajuster les mesures.
Qu’est-ce que cela révèle de la société ? Quel parallèle pouvez-vous établir avec la France, dont le phénomène de bande est en pleine recrudescence ?
Ces phénomènes de gang révèlent une physionomie sclérosée, une société malade. La gestion de ces phénomènes nous amène à remettre en question l’organisation de la société. Notre manière d’aménager nos territoires. L’organisation des rapports entre couches sociales. Ce n’est pas un problème de pays pauvre. Même aux États-Unis, en France, il y a des gangs. Toutes ces différences [sociales] traduisent un malaise. Que l’on soit un pays pauvre, ou un pays riche, le fait qu’il y ait des microbes, des bandes de jeunes délinquants, montre que la société telle qu’on l’a pensée ne marche plus. Il n’y a plus de repères. Avant — chez nous — l’école était le repère. Être instruit et travailler pour l’état. Aujourd’hui, l’école ce n’est plus la clé de la réussite. Ce qui marche, c’est travailler à son propre compte. Qu’importe l’entreprise, même si c’est l’entreprise de la violence. Ces bandes [délinquantes] sonnent l’alarme d’une société qui est en train de changer, de se métamorphoser, de muter.